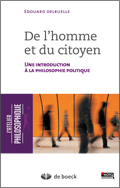Les 12 et 13 mai 2011, l’ Académie Royale de Belgique organisait à Bruxelles un colloque international « Les minorités, un défi pour les Etats ».
Quelle est la place du courant multiculturaliste dans le champ de la philosophie politique contemporaine, face aux deux grandes doctrines classiques que sont le libéralisme et le républicanisme ? Poser la question dans ces termes suggère que le multiculturalisme est un courant philosophique à part entière. Or cette hypothèse de travail se heurte à trois objections :
1) On observe que, dans ses versions philosophiques les plus solides (celles de Charles Taylor et Will Kymlicka), le multiculturalisme se présente, non pas comme un courant à part entière, constituant une alternative philosophique au libéralisme et au républicanisme, mais au contraire comme une tentative d’infléchir de l’intérieur le républicanisme (Taylor) ou le libéralisme (Kymlicka) ;
2) Le champ politique démocratique ne contient pas seulement ces deux courants systémiques (républicanisme et le libéralisme) – systémiques au sens où ils forment les deux pôles constitutifs de la matrice philosophique de la démocratie – ; on y compte également des courants « anti-systémiques » (selon l’expression d’Immanuel Wallerstein) – courants socialistes, révolutionnaires, postcoloniaux, subalternistes, etc., qui tout en s’opposant aux deux courants systémiques, appartiennent néanmoins à la même géoculture européenne, et partagent avec eux la même croyance dans le « grand récit » de la modernité, à savoir la croyance en une émancipation universelle, à la fois individuelle et collective, de l’humanité. Or, il existe aussi certaines formes de multiculturalisme qui entretiennent des rapports étroits et complexes avec ces mouvements anti-systémiques émancipateurs ;
3) A côté de ces différents multiculturalismes qui adhèrent globalement à la géoculture européenne et au projet de la modernité, il existe encore une autre forme de multiculturalisme, que l’on pourrait qualifier de communautariste ou différencialiste – multiculturalisme « profond » ou « hard » qui, lui, rejette frontalement ce projet culturel. Ce multiculturalisme ne fait pas l’objet de véritables théorisations philosophiques, mais on le trouve présent par exemple, dans les instances internationales comme l’ONU ou l’UNESCO, chez les représentants de certains pays arabo-musulmans ou africains. Ce multiculturalisme conteste la géoculture moderne dans sa globalité, dont il dénonce le caractère hégémonique et ethnocentrique. C’est au nom de ce différencialisme culturel qu’au sein du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, ces représentants justifient l’infériorisation de la femme ou la pénalisation de l’homosexualité, ou réclament l’interdiction du blasphème et de l’islamophobie.
La première chose qu’il faut dire, c’est donc qu’il n’existe pas un multiculturalisme, mais au moins deux, de nature très différente : d’un côté, un multiculturalisme « soft » qui appartient de plain-pied à la géoculture européenne, et qui se répartit en nuage, si l’on peut dire, sur toute la surface du champ philosophique, comme autant d’inflexions des courants existants (libéralisme, républicanisme, gauche anti-systémique) ; de l’autre côté, un multiculturalisme « profond », différencialiste, qui, lui, s’oppose à la culture européenne, et revendique pour les peuples non-européens, ou les populations allochtones vivant en Europe, de pouvoir vivre selon des standards culturels différents du « socle de valeurs » occidental, jugé hypocrite et corrompu.
Entre les deux formes de multiculturalisme, la différence n’est pas de degré, mais de nature. En vérité, le multiculturalisme « soft » fait le pari qu’une reconnaissance raisonnée des identités culturelles permettra d’éviter les conséquences désastreuses causées par le multiculturalisme « hard », à savoir le repli ethno-identitaire des diasporas « allochtones », et le « choc des civilisations » qui en est le corrélat géopolitique. Mais les adversaires libéraux, républicains et « socialistes » du multiculturalisme craignent au contraire qu’en faisant de trop grandes concessions aux revendications culturelles, on ne renforce ce repli ethno-identitaire et fasse ainsi basculer le « soft » dans le « hard », si l’on peut dire. Tels sont les termes du débat.
Quant à moi, je voudrais sortir de la question classique autour de la « reconnaissance » des minorités culturelles pour faire l’hypothèse que s’il existe aujourd’hui un multiculturalisme « profond » et différencialiste, défiant la géoculture moderne, c’est avant tout parce que cette géoculture est en crise profonde. Je propose donc d’inverser la façon d’envisager la question : ce n’est pas parce qu’il y a des minorités qu’il y a crise ou tension au sein de notre géoculture ; c’est parce qu’il y a crise de cette géoculture que surgit le « problème » des minorités. On ne peut donc isoler l’émergence du multiculturalisme de l’affaiblissement structurel de la culture occidentale – affaiblissement lui-même consécutif aux transformations profondes du capitalisme moderne.
Rappelons d’abord comment l’Etat-Nation européen a construit sa légitimité philosophique autour des deux courants que sont le libéralisme et le républicanisme. Ces deux courants représentent les deux pôles constitutifs de la modernité politique : le pôle individualiste qui considère que l’Etat a pour but essentiel de préserver les droits naturels des individus (« liberté négative », dans le vocabulaire d’Isaiah Berlin[1]), et le pôle civique qui considère que l’Etat a pour but la maîtrise collective par le groupe de son propre destin (« liberté positive »). Ces deux options ne sont pas exclusives, car elles activent le même principe éthico-politique fondamental, celui d’autonomie : les hommes instituent eux-mêmes l’ordre politique dans lequel ils vivent ; ils ne se définissent plus par leur appartenance à des collectifs hérités (communautés religieuses, clans, corporations, etc.), mais par leur capacité à auto-organiser leur existence individuelle et collective. Dans la mesure où ils déclinent ce qui est le noyau normatif de la modernité, ils peuvent être qualifiés de théories systémiques.
Entre les deux idéologies libérale et républicaine, il y a moins opposition que polarisation (c’est pourquoi je parle de « pôles », « individualiste » et « civique ») dans la mesure où chacune prétend englober l’autre. Le libéralisme postule que si les droits des individus sont préservés par l’Etat, un ordre juste émergera du libre jeu de leurs échanges et de leurs interactions ; le républicanisme prétend quant à lui que les individus ne peuvent s’épanouir individuellement que s’ils sont capables de transcender leurs propres intérêts individuels dans la recherche d’un Bien commun qui suppose leur participation active à la vie publique.
Le républicanisme et le libéralisme sont deux théories systémiques aussi dans la mesure où elles acceptent les deux caractéristiques fondamentales du système-monde européen : sur le plan économique, la primauté de la logique marchande (« capitalisme ») ; sur le plan politique, la logique de l’« Etat-Nation » (qui s’impose contre ses concurrents, l’Empire et les Cités-Etats, à travers une série de Révolutions violentes).
Comme on sait, dès le 19e siècle, ces deux postulats (économique et politique) vont être contestés par toutes sortes de mouvements anti-systémiques, à la fois anticapitalistes et internationalistes. Mais comme le montre très bien Immanuel Wallerstein, ces mouvements anti-systémiques (révolutionnaires, réformistes, anti- ou post-colonialistes) vont jouer un rôle paradoxal par rapport au système-monde marchand, dans la mesure où ils le contestent dans son mode d’organisation socio-économique et politique, mais en conservent la dynamique culturelle, celle de l’autonomie individuelle et collective. La quête d’autonomie est désormais présentée comme une Odyssée collective faite de luttes et de conquêtes progressives. Les mouvements anti-systémiques vont même donner à la modernité sa forme culturelle caractéristique, celle d’un « grand récit » de l’émancipation universelle. Chez Marx, le « sujet » collectif de ce grand récit est le prolétariat – sujet qui ne fait pas de place, notons-le, aux femmes, aux minorités et aux peuples colonisés comme tels.
De ce fait, les mouvements anti-systémiques vont paradoxalement servir « d’infrastructure culturelle à la relative stabilité » du système-monde marchand[2], car ils vont entretenir une perspective de progrès chez les populations fragilisées, une confiance indéfectible dans l’avenir (« nos enfants vivront mieux que nous », « demain sera meilleur ») …
La plus grande forme de stabilité sera atteinte avec le compromis historique conclu au sortir de la guerre entre forces du capital et forces du travail, et qui débouchera sur l’institution de l’Etat social de marché (terme qu’il faut préférer à l’expression « Etat-Providence »). La Belgique est (était ?) un cas exemplaire de ce compromis historique qui institutionnalise la tension entre composantes systémiques et anti-systémiques[3].
Je n’ai pas de vision idyllique de l’Etat social européen. La société salariale du 20e siècle était une société inégalitaire, assez peu redistributrice, mais protectrice, inclusive, assez en tout cas pour permettre aux plus défavorisés de mener une vie digne et de se projeter avec confiance dans l’avenir. Pour reprendre une image de Robert Castel, cette société a fonctionné comme un escalator : chacun restait sur sa marche, mais tout le monde montait [4].
Durant cette période, il n’existe aucun mouvement politique que l’on puisse caractériser comme relevant du « multiculturalisme ». Les minorités ont pourtant posé de nombreux défis et problèmes aux Etats occidentaux. Mais ces défis et problèmes étaient alors solubles dans le double cadre de l’Etat-Nation et de l’Etat social. Car de deux choses l’une. Soit se posait la question des minorités nationales, c’est-à-dire des « minorités » culturelles fortement implantées dans certaines zones territoriales, où elles réclamaient le droit à l’autodétermination. Dans ce cas, le conflit restait par principe dans le paradigme stato-national. L’issue de ces conflits, on le sait, a souvent été l’assimilation forcée ou la liquidation physique des dites minorités. Soit se posait la question de populations migrantes, diasporisées, mais dont les problèmes étaient alors assimilés à ceux des classes laborieuses en général. La question de l’intégration des immigrés ne fait pas l’objet d’une thématisation véritable avant les années 70-80. Les travailleurs migrants étaient considérés par les pays d’accueil (notamment la Belgique) comme des « travailleurs invités » censés retourner dans leur pays d’origine à la fin de leur contrat de travail. Cette fiction du « retour » était une forme de dénégation du fait migratoire, qui exonérait les pays d’accueil de toute prise en compte des spécificités culturelles de ces populations migrantes. Les mouvements anti-systémiques eux-mêmes partageaient cette logique, en considérant ces travailleurs migrants comme des travailleurs comme les autres censés assimiler (et s’assimiler à) la civilisation du travail – donc au grand récit moderne de l’émancipation ouvrière.
Durant cette période, il n’y a donc pas d’espace idéologique pour le multiculturalisme, car la construction de romans nationaux d’une part, l’adhésion à l’universalisme progressiste d’autre part, permettaient alors, non certes de résoudre, mais d’absorber les problèmes des « minorités »
Cette différence entre minorités nationales, occupant un territoire au sein d’une plus large entité politique dominée par un autre groupe ethnique majoritaire et minorités diasporiques de travailleurs se dispersant sur un territoire suite à une migration, cette différence est un locus classicus des débats autour du multiculturalisme[5]. Notons cependant que cette distinction ne rend pas compte de toutes les configurations : Noirs Américains, Gens du Voyage en Europe de l’Est, ou encore Juifs d’Europe avant la création d’Israël[6].
Vers les années 70-80, la configuration historique change radicalement. C’est à ce moment que le multiculturalisme va émerger sous ses deux formes, « hard » et « soft ».
Ce qu’on appelle la « globalisation » ou « mondialisation » est le triomphe historique d’une nouvelle forme de capitalisme qui relance spectaculairement la course au profit qui s’était érodée durant les « Trente Glorieuses ». Ce capitalisme présente trois caractéristiques bien connues :
– c’est un capitalisme postindustriel qui trouve de nouvelles sources de profit dans l’économie de l’immatériel et des services ;
– c’est un capitalisme global qui s’affranchit des barrières nationales, et qui s’impose désormais à l’ensemble de la planète grâce à la financiarisation de l’économie ;
– c’est un capitalisme ultralibéral (plutôt que « néolibéral ») qui rompt le compromis historique conclu avec le mouvement ouvrier, et qui entreprend de démanteler l’Etat social jugé trop onéreux.
Ce capitalisme global et ultralibéral va s’attaquer à la fois à l’Etat-Nation et à l’Etat-Providence : à l’Etat-Nation en tant que lieu d’institution d’un Bien commun, d’un projet collectif d’existence unissant des citoyens autour d’un même « roman national » ; à l’Etat-Providence en tant que forme de transaction entre forces sociales antagonistes (« compromis capital/travail »).
L’ultra-libéralisme est donc l’interruption du dialogue critique que le libéralisme historique entretenait avec le républicanisme (« quel roman national ? ») et le socialisme (« quel compromis social ? »). Or c’est ce dialogue critique permanent qui rendait vivant et crédible le grand récit moderne de l’émancipation de l’humanité. A partir du moment où les populations les plus fragiles du système-monde ont pris conscience qu’elles n’avaient plus prise ni sur leur environnement territorial (le roman national) ni sur le rapport de forces social (la tension capital/travail), le projet culturel de la modernité s’est trouvé logiquement décrédibilisé. Jean-François Lyotard a donné à cette chute des grands récits modernes d’émancipation le terme (contesté) de postmodernité[7]. Le multiculturalisme est en fait contemporain de ce tournant postmoderne ; je pense même qu’il en est la conséquence.
Le déclin de la géoculture moderne va d’abord se faire sentir chez les élites non-européennes, qui lui étaient pourtant jusque-là largement acquises. Rappelons en effet que les grands penseurs anticolonialistes de la modernité comme Franz Fanon[8], Aimé Césaire[9] ou Albert Memmi[10] ne remettaient pas en cause l’idéal européen d’autonomie individuelle et collective. Ils dénonçaient avec virulence le fait que les colonisés étaient absents de ce grand récit moderne d’émancipation, mais ils n’en contestaient ni la légitimité ni l’universalité.
Avec les mouvements tels que les Postcolonial Studies, Cultural Studies ou Subaltern Studies, un autre discours émerge chez les élites non-européennes. Elles ne font plus valoir qu’il y a des exclus du grand récit de la modernité, mais qu’il y a d’autres récits, une « contre-narration » (l’expression est d’Edward Said) qui oblige dorénavant l’Europe et l’Occident à « prendre l’Autre au sérieux »[11]. Selon l’expression d’un des penseurs-phare du courant subalterniste, D.Chakrabarty, le temps est venu de « provincialiser l’Europe »[12]. Les courants postcoloniaux, tiers-mondialistes et subalternistes, vont donc progressivement « décrocher » culturellement de la tradition anti-systémique occidentale, du marxisme en particulier.
Jean-Loup Amselle montre bien cette évolution, prenant l’évolution de la référence à Gramsci comme symptôme de ce décrochage. Les courants post-colonialistes ont en effet beaucoup emprunté aux catégories gramsciennes d’ « hégémonie » et de « subalternité ». Mais avec cette différence que Gramsci envisageait la position des groupes culturellement subalternes (dans son cas : la paysannerie de l’Italie du Sud) dans une perspective qui restait celle de l’émancipation collective du prolétariat (sous l’égide du Parti et de ses intellectuels « organiques »), tandis que les penseurs subalternistes du Sud vont autonomiser la perspective des groupes culturels minoritaires pour en faire une fin en soi. L’altérité, le métissage, la minorité, que Gramsci considérait comme des données de fait appelées à être dépassées dans le grand récit progressiste, deviennent des idéaux politiques en tant que tels[13].
Cette contestation du leadership culturel occidental va prendre, au niveau politique, de multiples formes, dont certaines très brutales et spectaculaires, comme la victoire de Khomeiny en Iran en 1979, suivi de la Fatwa contre Salman Rushdie dix ans plus tard. Un multiculturalisme profond voit le jour, dont le politologue conservateur Samuel Huntington déduira le fameux « choc des civilisations », quelques années avant le 11-Septembre [14].
Mais cette contestation « extérieure » du leadership occidental serait incompréhensible, il faut le redire, sans le coup d’arrêt « interne » porté par l’utra-libéralisme lui-même au grand récit de la modernité : liquidation brutale du mouvement ouvrier, extinction de la tension dynamique entre forces systémiques et forces anti-systémiques[15]. Même l’exigence de bien commun portée par le républicanisme a paru excessive à l’ordre marchand postmoderne …
Cet auto-effondrement de la géoculture moderne a donc eu pour double effet de décrocher les peuples non-européens de la culture politique européenne, mais aussi d’ôter tout espoir d’émancipation aux classes populaires en Occident. Comme l’explique très bien Wallerstein, les producteurs de l’économie-monde capitaliste, en s’attaquant au noyau critique et émancipateur de la géoculture moderne, « ont perdu le principal élément stabilisateur caché du système : l’optimisme des opprimés »[16]. Cette double situation (perte de croyance dans l’avenir chez les classes populaires autochtones et décrochage des populations allochtones par rapport à la géoculture moderne) est à l’origine de ce que nous diagnostiquons un peu vite comme le conflit des cultures. Un peu vite, car si conflit des cultures il y a, c’est parce s’est effondré ce qui faisait l’élément fédérateur paradoxal de la modernité, à savoir la culture du conflit.
Je le répète : le multiculturalisme s’engouffre dans le vide creusé par la crise ultralibérale. Il est le négatif, comme le gant retourné, de l’effondrement du grand récit d’émancipation qui caractérisait la modernité. Cet effondrement a favorisé l’émergence d’un multiculturalisme « profond », différencialiste et communautariste, qui conteste ouvertement la géoculture moderne et certains de ses acquis essentiels comme l’égalité femme/homme ou la liberté de critiquer les religions, ou qui n’hésite pas à ethniciser la question des banlieues et des diasporas immigrées[17].
Mais le capitalisme postindustriel a lui-même favorisé cette dynamique, au moins de deux manières. D’une part, le capitalisme de services a tendance à segmenter le marché en fonction des identités de chacun. Le commerce hallal, en plein essor, en est l’illustration classique, relativement inoffensive, mais qui montre combien le réflexe identitaire est apparié à la société marchande actuelle. D’autre part, on sait que dans nombre de pays, les dirigeants politiques, pressés d’en finir avec les politiques publiques à destination des plus démunis, ont souvent laissé le terrain social aux leaders religieux et communautaires. On ne peut donc dissocier l’émergence du multiculturalisme des avancées de l’ultra-libéralisme.
Qu’est-ce que le multiculturalisme « soft », philosophique, dans une telle configuration ? C’est la tentative de contrer ce multiculturalisme « hard » ou « sauvage » qui apparaît en creux de la postmodernité. Pour Charles Taylor, une politique de reconnaissance des cultures servira en fait à lutter contre les tentations de repli identitaire qui se manifestent au sein des minorités. Les philosophes multiculturalistes font le pari que, pour prévenir les dangers que représente le multiculturalisme « sauvage », il faut infléchir (mais sans les abandonner) les théories philosophiques traditionnelles : ainsi Charles Taylor va élaborer une variante multiculturaliste du républicanisme ; Will Kymlicka, une variante du libéralisme ; Alex Honneth, une variante de la pensée anti-systémique d’inspiration marxiste.
Héritier de Hegel, Charles Taylor pose que la reconnaissance est un « besoin vital »[18] de l’être humain. Avant même tout droit de penser et d’agir librement, il y a chez l’être humain un désir plus fondamental d’être respecté par les autres dans son identité propre (identité sociale, culturelle, sexuelle, etc.). Contre l’anthropologie libérale, Taylor pose que la condition de toute autonomie personnelle est la capacité de participer à une entreprise collective, d’appartenir à une communauté dotée d’un dessein collectif propre. C’est en ce sens que Taylor appartient à la tradition républicaine.
Mais dans le même temps, Taylor insiste sur le caractère dialogique de toute communauté civique. La recherche du Bien Commun n’est pas l’acception passive d’un Bien unique et culturellement homogène, mais consiste en une « fusion d’horizons » différents. Chacun doit donc être reconnu dans sa singularité (sexuelle, ethnique, culturelle, religieuse, etc.) pour pouvoir participer pleinement à cette république dialogique qu’est la démocratie. Taylor se refuse donc à confiner les croyances et les convictions dans la sphère privée (comme l’énonce un certain républicanisme « à la française »). Un tel positionnement justifie naturellement la panoplie classique des politiques multiculturalistes : neutralité inclusive (et non exclusive), discriminations positives, et évidemment les fameux accommodements raisonnables (dont Taylor a chaudement défendu le principe dans le Rapport rédigé sur cette question avec Gérard Bouchard [19]).
Mais il faut aussi bien voir la limite fondamentale apportée par Taylor à cette politique des identités : c’est que l’appartenance à la communauté politique doit toujours prédominer sur les identités culturelles (c’est sur cette base qu’il justifie son opposition au souverainisme québécois[20]). Les biens communs particuliers que sont les communautés culturelles doivent fusionner leurs horizons au sein d’un « méta » Bien commun, d’une méta-culture, si l’on peut dire, qui est le projet de la modernité. Autrement dit, pour Taylor, le droit à la différence culturelle ne peut pas conduire à rejeter la géoculture occidentale et ses acquis fondamentaux comme la liberté d’expression ou l’égalité femme/homme, par exemple.
Will Kymlicka, quant à lui, s’est efforcé de montrer que les mêmes revendications multiculturalistes pouvaient parfaitement se formuler dans la grammaire politique libérale, celle des droits individuels[21]. Kymlicka considère l’appartenance communautaire comme un bien individuel fondamental. Il est donc légitime, au nom du principe de non-discrimination et d’égalité de traitement (principes fondateurs du libéralisme), de prendre des mesures compensatrices pour permettre aux individus appartenant à des minorités de se défendre contre l’hégémonie de la culture dominante.
Dans cette perspective clairement individualiste, les droits culturels bénéficieront aux membres des minorités, mais aussi aux « dissidents » au sein de ces communautés (à ceux qui sont minoritaires dans leur minorité), et qui doivent pouvoir critiquer et contester leur tradition d’origine. Aux yeux de Kymlicka non plus, le droit de critiquer la /sa religion n’est pas négociable.
Une autre limitation des droits des minorités tient à la distinction, dont Kymlicka fait grand cas, entre minorités nationales et minorités ethniques. Selon lui, les minorités nationales ont une légitimité supérieure à revendiquer la reconnaissance de leurs spécificités, car elles occupent majoritairement un territoire depuis plus longtemps que ceux qui exercent le pouvoir, ce qui justifie qu’elles puissent gérer leur cadre de vie global, alors que les minorités ethniques, qui se sont constituées par des migrations individuelles, ont donc renoncé, du fait de leur décision de migrer, à revendiquer un tel droit.
Ces deux théories, on le voit, sont certes multiculturalistes si l’on considère les dispositions juridiques qu’elles promeuvent (actions positives, accommodements raisonnables, neutralité inclusive, etc.), mais l’une et l’autre évoluent dans des cadres philosophiques « classiques » – cadre républicain dans le cas de Taylor, cadre libéral dans le cas de Kymlicka. Dans les deux cas, l’exigence de pluralité culturelle se trouve conditionnée (donc limitée) par une exigence plus fondamentale, inconditionnelle, qui est l’existence d’un cadre politique et symbolique « moderne » susceptible de reconnaître cette pluralité. Or qu’est-ce qu’un cadre politique et symbolique à l’intérieur duquel les individus et les groupes peuvent dialoguer et coexister, sinon … une culture ? Et qu’est-ce qu’une culture, sinon un ensemble homogène de normes et de valeurs qui s’impose à tous les individus qui en dépendent ?
Nous sommes ici à un point nodal, où la multiculturalité se trouve limitée par cela même qu’elle essaye d’honorer : la spécificité d’une culture. Car le propre d’une culture est précisément de ne pas être un attribut optionnel dans la vie des individus, mais le cadre même dans lequel ils vivent, le sol de croyances et de normes à partir duquel ils font des choix comme individus. Ce point est un « impensé » dans nombre de discussions médiatiques ou politiques autour du multiculturalisme, où les protagonistes, quel que soit leur camp, feignent d’ignorer qu’une culture, ce sont des normes, donc des rapports de force et de pouvoir. Les partisans de modèles assimilationnistes négligent ainsi souvent la douleur, l’arrachement, les conflits de loyauté qu’engendre l’obligation faite aux membres des cultures minoritaires d’abandonner ce qui fait l’identité de leur communauté. Mais de leur côté, les partisans de modèles multiculturalistes taisent aussi les pressions sociales, psychologiques des communautés sur les individus qui désirent prendre leurs distances avec elles.
Pourtant, la plupart des traits culturels qui nous définissent nous sont imposés : origine, langue maternelle, système de parenté, mode de production, code de la civilité, etc. Ce qu’on appelle le métissage ou la créolisation est rarement une hybridation festive et recherchée par les individus, mais plus souvent un laborieux compromis entre pressions culturelles contradictoires. Toute culture cherche à s’imposer aux individus, car toute culture cherche à se perpétuer, à prolonger indéfiniment son existence. Aucune culture ne s’est jamais considérée comme transitoire, comme une simple option qui pourrait disparaître s’il ne se trouvait plus personne pour l’adopter. Une culture n’est donc pas seulement un espace de vie pour les humains, mais elle crée des humains tels qu’ils voudront imposer à leurs enfants l’habitus culturel que leurs parents leur auront transmis.
Que le socle de toute culture ne soit pas « négociable » ne signifie cependant pas qu’on ne puisse contester de l’intérieur sa propre culture. La géoculture européenne se caractérise même par le fait que la contestation intellectuelle et politique y est encouragée et institutionnalisée, à travers les dispositifs démocratiques de l’Etat-Nation (élections libres, droits de l’opposition, droit de manifester, désobéissance civile, etc.) et à travers la tension entre forces du capital et forces du travail au sein de l’Etat social (symbolisée par le droit de grève). C’est pourquoi les mouvements anti-systémiques font pleinement partie de notre géoculture, dont ils remettent en cause le mode d’organisation économique (le « capitalisme »), mais pas le cadre idéologique même, à savoir l’idéal d’autonomie individuelle et collective. Pour le dire autrement, notre géoculture admet la grève générale, voire la mise à sac d’un bâtiment public par des manifestants en colère, mais ne tolère pas (en dépit du principe de liberté individuelle) qu’une poignée de jeunes femmes sortent en rue vêtues d’un voile intégral. En vérité, il n’y a nul paradoxe, car si la désobéissance civile fait partie de notre géoculture moderne, le voile intégral, aussi minoritaire et inoffensif soit-il sur le plan social, contrevient à l’un des fondamentaux symboliques de notre géoculture, à savoir la reconnaissance réciproque des individus comme personnes, et leur égalité dans l’interaction – car voir sans être vu, pouvoir identifier quelqu’un en se soustrayant soi-même à toute identification crée une dissymétrie, une inégalité manifeste dans la relation sociale qui est la négation de toute autonomie de la personne. Par contraste, un syndicaliste qui saccage les bureaux de la direction de son usine procède à une sorte de rituel social conforme à toute une tradition de lutte sociale qui est le cœur même de la société industrielle.
Charles Taylor et Will Kymlicka, qui savent pertinemment cela, concentrent donc leur réflexion autour de deux questions principales :
- Quel est le socle culturel commun, inconditionnel qui doit s’imposer aux individus et aux cultures minoritaires ? Comment empêcher que ces cultures minoritaires ne s’imposent à leurs membres au point de les couper de la méta-culture commune ? Le pari des multiculturalistes est qu’une large reconnaissance du droit des individus à vivre selon leurs convictions et leurs croyances est encore le meilleur moyen d’empêcher l’enfermement identitaire ;
- A partir de quand, et à quelles conditions, une minorité culturelle peut-elle obtenir une forme d’autonomie par rapport à la culture dominante ou majoritaire ?
Cette question est au cœur de la discussion autour de la Charte de la langue française en vigueur au Québec, qui interdit notamment la fréquentation d’écoles anglophones aux enfants francophones et migrants. Une telle disposition est une limitation flagrante du droit culturel des individus (choisir sa langue d’enseignement), mais cette limitation se justifie, selon Charles Taylor, au nom d’un droit culturel supérieur, qui est le droit des cultures de se perpétuer, de s’imposer comme un Bien commun subsumant les droits individuels[22]. Evidemment, cette disposition est indissociable d’autres qui définissent la culture québécoise comme un cadre symbolique et normatif quasi-global d’existence, au point que la question de la souveraineté est explicitement posée. La question, faut-il le dire, a de multiples résonances en Belgique … Quant à Kymlicka, sur la même question, il active opportunément la différence entre minorités nationales et minorités ethniques : les québécois, majoritaires sur leur territoire et installés depuis longtemps, peuvent avoir recours au principe de survie collective, à la différence des minorités migrantes, dispersées et plus récemment arrivées.
Quand on parle de « culture », on désigne donc deux choses différentes : d’une part, la culture comme socle commun de normes, « Tiers symbolique » définissant l’espace global à l’intérieur duquel les individus communiquent ; d’autre part, la culture comme communauté définie par un trait existentiel isolé (religion, ascendance, éventuellement langue ou même orientation sexuelle ou style de vie) – communauté pourvoyeuse de sens, d’identité, mais dépourvue d’emprise normative sur le cadre de vie global des individus.
Quel est le critère qui permet de distinguer les deux formes de culture ? Je soutiens quant à moi que ce critère est le rapport à la matérialité de l’existence, et notamment à cette dimension de la matérialité qu’est le territoire. La culture au premier sens est d’abord le cadre à l’intérieur duquel les individus expriment leur puissance de vie, de travail, de langage : rapports de parenté ; rapports de production ; rapports « médiatiques » (au sens large, aujourd’hui : les médias, mais aussi l’enseignement). Les localisations matérielles contemporaines de ces institutions fondamentales sont le logement, l’emploi et l’école. Ces institutions fondamentales sont reliées entre elles pour former le socle de base de la vie sociale sur un territoire donné. La culture au 2e sens désigne autre chose : l’appartenance à une communauté dotée d’une identité spécifique – communauté qui opère comme une coupe transversale à travers le vécu des individus pour isoler certaines pratiques, certaine dimensions de l’existence qu’elle prétend régir (la croyance, la sexualité, le savoir, etc.)..
Je suggère d’appeler géoculture la culture matérielle qui organise le cadre de vie global d’une population sur un territoire donné, et ethnocultures les communautés d’appartenance à travers lesquelles je me reconnais, je m’identifie. Cette terminologie est plus pertinente, me semble-t-il, que les catégories de « majorité » et de « minorités » qui sont trompeuses car elles transforment en différence statistique ce qui en fait une différence de nature : une géoculture est le Tiers symbolique inconditionné à l’intérieur duquel tout dialogue, toute contestation, tout choix (attachement ou arrachement) sont possibles sur un territoire donné, tandis que les ethnocultures, elles, ne sont que des segments identificatoires optionnels, car les individus peuvent théoriquement « choisir » d’être chrétiens, athées ou musulmans, néerlandophones ou francophones, homosexuels ou hétérosexuels, etc. Entendons que le « choix » ne porte pas ici sur le segment existentiel lui-même, que la contingence nous impose comme une donnée de fait, mais sur l’appartenance à la communauté qui socialise ce segment. Car personne n’échappe à son ascendance, son origine, ni même sans doute à son « orientation » sexuelle ; par contre, l’individu reste libre, ou doit en tout cas pouvoir rester libre, de s’identifier ou non à telle communauté d’appartenance – juive, marocaine, lesbigay, etc.
Selon ma typologie, la culture catholique en Belgique n’est qu’une ethnoculture, même si elle rassemble une majorité de Belges. Par contre, une minorité nationale est une géoculture, car elle prétend structurer l’ensemble du cadre existentiel des individus sur un territoire donné. Dans les débats autour du multiculturalisme, la confusion entre géoculture et ethnocuture est pourtant constante, comme on l’a vu de façon caricaturale lors de la votation suisse sur les minarets, ou dans le débat autour des « racines chrétiennes » de l’Europe. On peut interpréter toute la philosophie politique de Habermas comme une tentative pour dés-ethniciser la géoculture démocratique, à travers l’idée de « patriotisme constitutionnel ».
Sur un territoire donné, il n’y a en principe qu’une seule géoculture, un seul ensemble symbolique, politique et matériel. Dans les sociétés complexes comme les nôtres, cet ensemble forme souvent une sorte de poupée-gigogne où s’emboitent plusieurs niveaux politiques – local, régional, national, continental. La politique est la concurrence plus ou moins réglée entre pouvoirs pour l’appropriation d’un même espace géoculturel. Et la guerre sous sa forme « classique » n’est rien d’autre, selon la formule de Clausewitz, que « la continuation de la politique par d’autres moyens ». Durant la modernité, les guerres ont pris une dimension interculturelle sous l’influence du nationalisme, qui active le mythe d’une concordance parfaite entre entité politique et ensemble culturel. On peut d’ailleurs soutenir que le nationalisme est aux géocultures ce que le multiculturalisme est aux ethnocultures, à savoir une justification idéologique de la reconnaissance des communautés d’appartenance.
Mais la différence, c’est que s’il n’y a qu’une seule géoculture sur un territoire donné, il peut y avoir plusieurs ethnocultures entretenant entre elles des rapports tantôt harmonieux tantôt difficiles, mais dont la géoculture est en principe l’arbitre, à condition toutefois qu’elle ait suffisamment de consistance et de cohérence pour s’imposer effectivement comme le « Tiers interculturel ». Car quand la géoculture est elle-même défaillante, incapable d’assurer les besoins existentiels fondamentaux des individus, les tensions entre ethnocultures sont attisées, car celles-ci apparaissent à leurs yeux comme les seules ressources capables de compenser le vide ainsi creusé.
C’est bien ce qui arrive aujourd’hui. La crise de la géoculture moderne a mécaniquement provoqué une montée en puissance des ethnocultures qui cherchent dès lors à être reconnues comme partenaires actifs de la vie sociale et institutionnelle.
Si les conflits contemporains se présentent comme des guerres de « civilisation », c’est paradoxalement parce que l’ordre marchand a liquidé toute véritable assise géoculturelle à l’existence concrète, quotidienne des individus. Ce n’est pas un hasard si les débats les plus intenses autour de l’interculturalité portent sur la pression de plus en plus forte exercée par les ethnocultures sur les institutions fondamentales de la vie, du travail et du langage : débats autour des rapports homme/femme, de la famille patriarcale, de la polygamie, des mariages arrangés ou forcés ; au niveau économique, crainte de voir certaines diasporas organiser des circuits économiques parallèles, voire une économie souterraine ; au niveau « médiatique » (au sens propre de production et de transmission de l’information), débats autour de l’école ou du socle épistémique « non-négociable » (cf. la querelle autour du créationnisme).
Ce que je voudrais pointer, c’est donc que si les ethnocultures (« minorités ») apparaissent comme des éléments déterminants de notre environnement global, si elles donnent le sentiment de saturer l’espace public, c’est parce qu’il y a faillite culturelle, matérielle, politique de la géoculture moderne – faillite de ses institutions sociales (famille, emploi, école), de ses mécanismes politiques (démocratie représentative, négociation sociale) et de ses schèmes symboliques (le grand récit de l’autonomie individuelle et collective) …
Le problème n’est donc pas dans l’archaïsme de l’islam, ni dans l’arrogance de l’Occident à l’égard des « autres », il est dans la crise de la géoculture européenne incapable d’offrir un cadre cohérent d’existence à l’ensemble de ses membres, qu’ils soient autochtones ou allochtones. Le déclin des mouvements anti-systémiques et la fin du compromis social ont eu pour conséquence que la situation des diasporas qui peuplent aujourd’hui nos banlieues et nos quartiers est perçue par tout le monde, à commencer par les intéressés eux-mêmes, comme un problème culturel touchant des minorités ethniques ou religieuses, et non comme un problème social touchant en fait la frange la plus précarisée du prolétariat postindustriel.
C’est pourquoi il est urgent, selon moi, d’inverser la dynamique en retournant aujourd’hui des conflits culturels vers les conflits sociaux, des revendications multiculturalistes vers les résistances anti-systémiques.
Dans cette perspective, il est intéressant de se tourner vers la philosophie de la reconnaissance d’Axel Honneth, qui vise quant à lui à infléchir le socialisme anti-systémique dans le sens d’une prise en compte des revendications multiculturalistes. Honneth part du principe que la question de la justice ne se réduit pas à la distribution des biens et des avantages, mais touche aussi à celle au déni de reconnaissance, aux souffrances subjectives éprouvées par les individus. L’injustice n’est pas seulement « avoir » moins qu’autrui, mais aussi ne pas être reconnu comme un égal par les autres. Cette perspective morale, subjective, lui permet de porter attention aux discriminations fondées sur le genre, la « race », l’origine ou la culture. En fin de compte, Honneth propose même d’englober la question de la justice au sein d’une théorie générale de la reconnaissance. L’inflexion est si radicale que Nancy Fraser a accusé le philosophe allemand de trop « psychologiser » la question de la justice sociale. Entre les deux philosophes, le débat se situe donc à un niveau que je qualifierai de métapolitique : il s’agit de savoir si les revendications de reconnaissance doivent être interprétées dans le cadre d’une théorie globale de la justice sociale (c’est la thèse de Fraser), ou si les revendications de justice sociale doivent être interprétées comme des revendications de reconnaissance (c’est la thèse de Honneth) [23].
Pour ma part, j’opte pour la voie préconisée par Nancy Fraser. L’injustice, soutient-elle, ce n’est pas souffrir d’une relation déformée à soi-même, mais se voir dénier le statut de partenaire dans l’interaction sociale. La non-reconnaissance elle-même ne consiste pas seulement à être victime des attitudes et des stigmatisations dénigrantes des autres, mais à être empêché de vivre comme acteur à part entière au sein de la Cité. Sur cette base, Nancy Fraser propose une conception « bidimensionnelle » de la justice, qui conjugue reconnaissance et redistribution, et dont le pivot normatif est l’égalité de participation à la vie sociale, ce qui replace les questions de justice sociale et de non-discrimination au cœur du problème, contre toute approche trop « culturaliste » des conflits contemporains.
Je conclurai donc en redisant ce que je ne cesse de répéter avec quelque insistance, au risque d’irriter [24], à savoir que le défi que représente le multiculturalisme ne peut être relevé à un niveau culturel, mais à un niveau plus global (le devenir même du système-monde marchand) et plus matériel (la refondation de l’Etat social). La question multiculturelle ne peut être isolée de la question sociale qui demeure aujourd’hui le défi majeur auquel les Etats sont confrontés – défi plus crucial sans doute que celui posé par les minorités elles-mêmes …
[1] Isaiah Berlin, Eloge de la liberté, Calmann-Lévy, 1969.
[2] Immanuel Wallerstein, Sortir du monde états-unien, trad. I.Farny, Liana Levi, 2004, p.92.
[3] D’où la question de Wallerstein : « ne serait-il pas plus juste de dire qu’il n’y a jamais eu qu’une seule idéologie véritable depuis 1789 : le libéralisme, qui s’est déployé sous trois variantes particulières ? » Wallerstein, L’après-libéralisme. Essai sur un système-monde à réinventer, trad. P.Hutchinson, Aube, 1999.
[4] Robert Castel, L’insécurité sociale, Seuil /La République des Idées, 2003, p.38
[5] Elle est au centre de la réflexion de Will Kymlicka, La citoyenneté multiculturelle. Une théorie libérale du droit des minorités (1995), La Découverte, 2001.
[6] Ce qu’on appelait jadis « la question juive » provenait précisément de ce que la diaspora juive n’était ni une minorité nationale pouvant revendiquer son rattachement à une Nation originaire, ni une population poussée à migrer pour des raisons économiques. Le sionisme sera l’effort d’apparier le peuple juif à l’une ou à l’autre de ces deux configurations : doter la communauté juive d’une conscience nationale luttant pour l’obtention d’un territoire (voie préconisée par Theodor Herzl) ou assimiler la conscience juive à celle du grand récit prolétarien (voie préconisée par le Bund). L’histoire du Foyer National Juif et de l’Etat d’Israël naissant témoigne de la volonté de faire converger ces deux voies.
[7] Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Minuit, 1979.
[8] Franz Fanon, Les Damnés de la Terre (1961), réédition La Découverte, 2002.
[9] Aimé Césaire, Discours sur le Colonialisme (1950), Présence africaine, 1989.
[10] Albert Memmi, Portrait du colonisé, précédé du portrait du colonisateur, Buchet/Chastel, 1957.
[11] « Le subalterne et le constitutivement différent formèrent soudain une articulation perturbatrice exactement là où, dans la culture européenne, on pouvait auparavant compter sur le silence ou la servilité pour les faire taire » (Edward Said, Réflexions sur l’exil et autres essais (2000), trad. C.Woilliez, Actes Sud, 2008, p.408.
[12] Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe. La pensée postcoloniale et la différence historique, trad. O. Ruchet et N. Vieillescazes, Editions Amsterdam, 2009. Le pionnier de cette « révolution copernicienne » est Edward Said, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, trad. C.Malamoud, Seuil, 1980 ; Culture et Impérialisme, trad. P.Chemla, Fayard, 2000. Pour une présentation synthétique des théories postcolonialistes et subalternistes ayant inspiré le courant multiculturaliste, cf. Franscesco Fistetti, Théories du multiculturalisme, La Découverte, 2009.
[13] J-L.Amselle, L’Occident décroché. Enquête sur les postcolonialismes, Stock, 2008.
[14] Samuel Huntington, Le choc des civilisations, Odile Jacob, 2007.
[15] Pour qualifier ce processus de liquidation du conflit social et politique entre droite et gauche, Francis Fukuyama parlera de « fin de l’histoire ». En fait, le « choc des civilisations » et « la fin de l’histoire », qui paraissent porter des diagnostics opposés sur la situation politique, signifient donc exactement la même chose : la (prétendue) liquidation du projet culturel moderne.
[16] Immanuel Wallerstein, Comprendre le monde. Introduction à l’analyse des systèmes-monde, trad. C.Horsey, La Découverte, p.134, 2004.
[17] Je songe par exemple au mouvement des « Indigènes de la République » en France.
[18] Charles Taylor, Multiculturalisme, différence et démocratie, Paris, champs Flammarion, p.42.
[19] La Commission Bouchard-Taylor (officiellement, la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles) fut créée pour examiner les questions liées aux accommodements raisonnables consentis sur des bases culturelles ou religieuses au Québec. Le rapport final de la commission a été rendu public en 2008.
[20] La frange national-populiste du courant souverainiste québécois rejettera d’ailleurs le multiculturalisme taylorien au motif qu’il serait un instrument de la culture anglophone dominante pour empêcher l’expression de l’identité politique québécoise. Cette polémique illustre bien le jeu de miroir entre l’ethno-populisme allochtone et le national-populisme autochtone (en l’occurrence ici : québécois), et la volonté de Taylor de les contrer l’un et l’autre en leur permettant de s’exprimer à l’intérieur du cadre d’une république dialogique.
[21] Will Kymlicka, La citoyenneté multiculturelle. Une théorie libérale du droit des minorités (1995), La Découverte, 2001.
[22] Charles Taylor, Multiculturalisme, différence et démocratie, Paris, champs Flammarion, p.76.
[23] A.Honneth, La Lutte pour la reconnaissance (1992), trad. P.Rush, Cerf, 2008. ; Axel Honneth et Nancy Fraser, Redistribution or Recognition?: A Political-Philosophical Exchange, Verso, 2003.
[24] Cf. ma « note minoritaire » dans le Rapport final des Assises de l’Interculturalité.