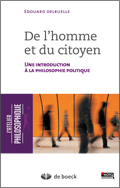Du 23 au 25 avril 2010, la Professeure Marie-Claire Caloz-Topsch organisait à l’Université de Lausanne un colloque intitulé « La pensée et l’action dans le pouvoir. Colère : dynamiques soumission-insoumission et création politique ».
Résumé de ma communication :
La situation politique et géopolitique actuelle est caractérisée par la « mondialisation » et le « choc des civilisations », c’est-à-dire une violence à la fois économique (« objective ») et identitaire (« subjective »). Cette situation peut-elle être appréhendée dans les termes d’une grammaire des passions politiques ? L’objet de ces notes est de suggérer que oui. L’hypothèse de travail développée ici est que la typologie spinoziste « passions tristes versus passions joyeuses » s’applique au phénomène majeur de notre temps : la production virulente de non-monde, de zones et de populations surnuméraires, superflues, qui elle-même débouche sur des conflits de type identitaire. Ce n’est qu’à cette condition (comprendre pourquoi les fractures sociales se traduisent en luttes identitaires) que l’on pourra faire le chemin en sens inverse : réinvestir les enjeux sociaux, matériels et historiques, au détriment des questions d’identité et d’ethnicité qui surdéterminent aujourd’hui les débats publics.
1. La thématique classique des passions permet de franchir un pont entre ce que E.Balibar appelle la violence « ultra-objective » (à savoir le traitement économique de masses d’hommes en choses, en résidus surnuméraires) et la violence « ultra-subjective » (à savoir la production fantasmatique de l’étranger en Autre irreprésentable qu’il faut extirper du corps propre de notre « identité »). Les deux explications (l’une par Marx, l’autre par Freud) paraissent parallèles et même complémentaires, et en même temps rigoureusement incompatibles sur le plan conceptuel. On peut gager que la thématique des passions permet d’expliquer le transfert ou la surdétermination (dixit Balibar) d’un type de conflit dans l’autre[1].
2. La thématique des passions permet également d’envisager le dissensus, le conflit comme une dynamique soit positive soit négative – soit comme exacerbation de la violence et de la domination, soit comme résistance, solidarité, bref comme production de philia politikè. Ainsi, le même affect (la colère) peut-il être interprété, selon le contexte et la dynamique des acteurs, comme passion triste ou comme passion joyeuse, et donc susceptible de produire des effets antinomiques dans le champ social. Suivant Spinoza, on montrera que l’enjeu d’une politique est moins de faire triompher la rationalité elle-même sur les passions, que les passions joyeuses sur les passions tristes.
3. Chez Spinoza, on le sait, l’homme est caractérisé par son effort pour persévérer dans l’existence (et non par un conflit entre raison et passion, ou bien et mal). On peut aussi appeler cet effort : désir. L’esprit (incluant les passions) n’est pas une chose mais une activité, celle de penser le corps et le monde (et l’insertion de ce corps dans ce monde). L’esprit n’agit pas sur le corps, pas plus que le corps sur l’esprit. Le rapport n’est pas de causalité ni d’interaction mais d’expression : l’esprit et le corps expriment la même puissance d’exister, le même désir. Ce désir s’actualise soit comme accroissement soit comme diminution de la puissance subjective concrète – puissance de vie, de travail et de langage. Quand cette puissance augmente, elle est effectivement vécue par l’esprit comme joie, c’est-à-dire affirmation de la vie et de la pensée ; quand cette puissance diminue, elle est inversement vécue par l’esprit comme tristesse, c’est-à-dire réduction de la vie et de la pensée. Les passions joyeuses réalisent l’essence même du désir, qui est l’effort affirmatif de la subjectivité complète, totale, se déployant dans toutes ses dimensions. Les passions tristes expriment le mouvement contraire, qui est la réduction de la puissance d’exister, la séparation de la subjectivité d’avec certaines de ses dimensions existentielles fondamentales.
4. Je pense que la polarité spinoziste joie / tristesse est adéquate pour comprendre les affects politiques contemporains, et les formes de conflit qu’ils expriment. Mon hypothèse est que la dynamique passionnelle des conflits identitaires (« la lutte pour la reconnaissance ») est tendanciellement négative au sens de Spinoza (car n’exprimant que partiellement, donc inadéquatement et négativement, notre puissance subjective), tandis que la dynamique des conflits sociaux est tendanciellement positive (car exprimant totalement, donc adéquatement et positivement, la puissance de vie, de travail et de langage du sujet). Cela ne veut pas dire que tous les conflits sociaux débouchent nécessairement sur une libération ou une émancipation, mais qu’ils possèdent un tel potentiel, tandis que les luttes de reconnaissance de type identitaire ou communautaire ne produisent tendanciellement que des affects négatifs et sont incapables de produire par elles-mêmes quelque passion joyeuse.
5. Tout l’enjeu réside dans la confusion entre subjectivité et identité. La subjectivité exprime la puissance d’exister de l’être humain dans l’unité et la pluralité de son être, dans toutes ses dimensions. Tandis que l’identité est un « segment » de subjectivité (genre, nationalité, ethnie, religion, langue, etc.) rapporté non à l’ensemble des dimensions du sujet, mais à l’écart différentiel d’avec d’autres identités (homme/femme, chrétien/musulman, homosexuel/hétérosexuel). Il faut tenir ferme que la subjectivité humaine ne se réduit pas à l’identité, que toute subjectivité se manifeste à travers une puissance existentielle qui n’est pas identitaire mais historico-matérielle, et que c’est ce noyau existentiel profond qui sert de socle à toute égalité et toute universalité des êtres humains.
6. Allons un peu plus loin. Ce que j’appelle puissance ou noyau existentiel(le), c’est le fait que tout être humain est d’abord un être vivant, travaillant et parlant, un être dont les besoins, les désirs, la conscience s’articulent autour de ces trois pôles que sont la vie, le travail, le langage, ou si l’on veut : le sexe, le geste et la parole. Cette puissance subjective de vie, de travail et de langage est socialisée, captée, assujettie par le pouvoir et les normes, dans des rapports sociaux fondamentaux : rapports de parenté, rapports économiques et rapports « médiatiques » (au sens premier de système de production et de transmission de l’information). L’ensemble de ces rapports constitue pour chaque subjectivité un monde, « son » monde qui est donc « toujours déjà » politique.
7. L’absence de monde, la désolation au sens arendtien (acosmie, worldlessness) naît de la situation de non-rapport social, économique et/ou médiatique, donc de non-rapport politique, d’impossibilité pour l’être humain d’actualiser sa puissance subjective de vie, de travail et de langage dans un espace-temps social, public. L’enfermement (ou, dans les sociétés traditionnelles, le bannissement), plus encore que la misère, est l’expérience-type du non-monde.
8. Les identités et les appartenances ne sont que des « segments », des dimensions toujours partielles de l’existence : « race », langue, religion, ethnie ; mais aussi genre, âge, santé physique et mentale, orientation sexuelle. Quelle est la fonction des identités et des appartenances ? Non pas de satisfaire des besoins vitaux et sociaux fondamentaux, mais de donner un certain statut symbolique (inférieur ou supérieur), une certaine identité (positive ou négative), à des traits « donnés » par la nature et/ou par l’histoire. Les identités transforment donc les traits « naturels » en marqueurs « culturels » : elles transforment le sexe (donnée « naturelle ») en genre (construction « culturelle »); l’âge en générations ; l’orientation sexuelle en identités sexuelles ; la couleur de peau en prétendues « races », la langue en communauté linguistique, la pratique religieuse en religion, etc. Ces marqueurs culturels permettent aux hommes de se reconnaître les uns les autres en se distinguant, en se différenciant les uns des autres : homme/femme, jeune/vieux, hétéro/homo, Blanc/Noir, langue majoritaire / langue minoritaire, chrétien/musulman, etc.
9. Toute assignation identitaire, tout statut d’appartenance est par nature discriminatoire et inégalitaire. Toute affirmation ou reconnaissance identitaire se construit par opposition, distinction, hiérarchisation. Par conséquent, la reconnaissance mutuelle des identités est anthropologiquement impossible. Un monde où nous serions « riches de nos différences » est une vue de l’esprit. Les revendications identitaires expriment par nature des passions tristes, jamais des passions joyeuses.
10. Pourquoi toute reconnaissance statutaire ou identitaire est-elle une lutte sans fin pour la reconnaissance ? Précisément parce que l’égalité existentielle des êtres humains, leur absolue équivalence ou indétermination comme êtres vivant, travaillant et parlant, que cette égalité est une donnée immédiate de la conscience, qui s’impose a priori à n’importe quel acteur de la vie en société. Or cette égalité devant la vie, la mort, la maladie, l’effort physique, le langage, cette équivalence entre les humains est un principe littéralement anarchique au sens où il détruit et subvertit toute archè, tout fondement, c’est-à-dire tout ordre social. Les identités et les appartenances ont pour but de conjurer ce principe égalitaire anarchique, qui instille l’idée (socialement et psychologiquement insupportable) que toutes les places, toutes les fonctions sont interchangeables : qu’une femme peut prendre la place d’un homme, ou qu’un homme peut devenir femme, qu’un Noir vaut un Blanc, qu’un serviteur peut contester le maître, et l’élève le professeur, qu’un homosexuel peut devenir père, un catholique, musulman, ou un musulman, homosexuel, etc. Cette indétermination de l’humain, cette équivalence de n’importe qui avec n’importe qui, est donc à la fois :
- la condition absolue de toute vie en société, de tout rapport social, même inégalitaire et discriminatoire. Car pour établir une relation de domination, il faut une foule de petites relations égalitaires qui reposent sur la conscience immédiate qu’un être humain n’est pas un cochon ou un chou-fleur ;
- et en même temps cette indétermination est le scandale absolu, celui de l’indifférence, de l’anarchie, du relativisme généralisé, qu’il s’agit de conjurer et de refouler à travers des partages identitaires qui fixent à chacun sa place.
11. Le pouvoir et les normes interviennent dans le champ identitaire très différemment que dans le champ historico-matériel : ici, il assujettit la puissance subjective des êtres humains ; là, il conjure leur égalité anarchique. C’est pourquoi il y a une grande différence entre les conflits qui traversent le champ matériel et historique, et les conflits qui caractérisent les identités.
Dans le champ social-historique, le pouvoir canalise et oriente des flux (de femmes, de biens, d’informations), il répartit, distribue, contrôle, selon une logique dedans/dehors, si bien que les conflits sont des conflits d’intérêt (au sens de l’inter-esse : ce qui est entre les acteurs sociaux), des conflits entre des acteurs qui partagent un même monde et qui se disputent celui-ci, qui se battent, « entre hommes », pour une terre, un titre, une femme, etc. La forme extrême de violence est alors la réduction de l’être humain en chose, résidu sans utilité.
Dans le champ identitaire, le pouvoir classe, stigmatise, exclut selon une logique nous/eux. Les conflits identitaires sont en fait des conflits dont l’enjeu est la qualification même de ce qui est humain – humain, sous-humain, inhumain ; ou encore civilisé (plus humain) et barbare (moins humain). Les frontières entre homme et femme, Blanc et Noir, Chrétien et Musulman, hétérosexuel et homosexuel, etc., sont des frontières qui hiérarchisent des modes d’humanité et de civilisation : des modes supérieurs (mâle, Blanc, Chrétien, hétéro) et des modes inférieurs (femme, Noir, Juif, homo, etc.). Ces hiérarchies, ces classifications définissent la « culture », la « civilisation », par contraste avec ce qui marqué comme barbare ou sauvage.
12. Les formes extrêmes de violence découlent alors de la représentation d’individus ou de groupes comme figures de l’inhumain, incarnations du mal, menaçant le sujet identitaire de l’intérieur. Car si les autres (« eux ») sont identifiés comme non-humains ou sous-humains, « nous » sommes fondés à les traiter comme on traite des non-humains. « Le barbare, c’est d’abord l’homme qui croit à la barbarie », dit Lévi-Strauss. C’est-à-dire : le barbare, c’est d’abord l’homme qui croit à la civilisation, qui croit à la culture, qui croit au partage entre civilisation et barbarie, au point d’entrer dans une relation spéculaire avec l’autre jugé « inhumain », « non civilisé » : « c’est dans la mesure même où l’on prétend établir une discrimination entre les cultures et les coutumes que l’on s’identifie la plus avec celles qu’on essaye de nier »[2].
13. C’est pourquoi toute assignation identitaire (raciale, ethnique, sexuelle) porte toujours en elle le germe d’une violence (réelle ou symbolique) qui, je le répète, se distingue de la violence sociale et politique : dans le champ social et politique, la violence est amortie par la matérialité des rapports sociaux (on se bat pour quelque chose de déterminé, de « fini »), si bien qu’on peut donc toujours discuter, négocier, transiger, tandis que dans le champ des identités, la violence se déploie dans l’imaginaire qui est infini, un « mauvais infini » où les hommes se battent pour leur humanité même, au nom de l’humain contre l’inhumanité fantasmée de l’autre.
14. Toute la question est évidemment de savoir quels rapports entretiennent entre elles ces deux logiques passionnelles, ces deux types de conflit. Autrement dit, comment les affects potentiellement joyeux (espoir, solidarité, indignation, révolte, etc.) se transforment-ils en affects tendanciellement tristes (crainte, défiance, concurrence, haine, résignation, etc.), et vice et versa ? Dans Violence et civilité, E. Balibar exclut lui aussi, en bon spinoziste, l’idée d’un rapport de causalité ou même d’une interaction entre les deux plans matériel et identitaire, tout en reconnaissant en même temps que les mêmes affects circulent d’un plan à l’autre : « s’il nous faut maintenir que les formes de la violence ultra-objective et ultra-subjective ne se confondent ni conceptuellement ni pratiquement, et qu’aucune en ce sens n’est la raison ou la cause ultime de l’autre, « déterminante en dernière instance », il n’en faut pas moins reconnaître que toute une série de phénomènes dans notre expérience historique, en particulier le racisme lorsqu’il coïncide avec le déchaînement d’une violence inconvertible, superposent les deux formes ou circulent entre elles »[3]. Un peu plus loin, il propose de voir les transferts de passions d’un plan à l’autre comme une surface de Möbius : « les manifestations ou phénomènes de la violence « ultra-subjective » (commandées par l’obsession de l’identité) et celles de la violence « ultra-objective » (résultat de la réduction d’êtres humains au statut de choses inutiles, donc superflues ou « en trop ») peuvent continûment passer les unes dans les autres, tout en restant essentiellement hétérogènes. Inconvertibles, chacun dans son ordre, les excès de la « souveraineté » et ceux de la « marchandisation » (les renversements de la constitution des communautés et ceux du commerce et de l’universalisation des échanges) le sont plus encore, peut-être, du fait qu’ils ne cessent de se surdéterminer »[4].
15. Selon moi, cette surdétermination fonctionne de la manière suivante : l’angoisse identitaire (quelle sorte d’humain suis-je ? quel barbare « l’autre » est-il ?) saisit toute subjectivité historique à mesure que lui échappe l’enjeu historico-matériel (qu’est ce que le monde dans lequel nous vivons ?). L’inflation des discours sur l’humanité, l’humanitaire ou l’humanisme signale généralement une chute du taux de mondanité (worldliness), et donc aussi du taux de politicité. Nous devons suivre l’intuition philosophique géniale d’H.Arendt selon laquelle la question politique primordiale n’est pas celle de l’homme ou de l’humanité, mais celle du monde : « La politique au sens strict du terme n’a pas tant affaire aux hommes qu’au monde qui est entre eux et qui leur survivra ». Quand le monde s’efface entre les hommes, quand ceux-ci sont privés de monde, seuls face à eux-mêmes, alors c’est leur humanité-identité qui se trouve en jeu. Quand la lutte entre les hommes cesse d’être une lutte dans et pour le monde, elle se métamorphose en lutte pour la reconnaissance, en lutte spéculaire, sans fin, des individus pour être reconnus des autres comme humains.
16. En d’autres termes, les identités ne sont que des puissances subjectives sans monde (éprouvant la tristesse comme acosmie, désolation). A l’inverse, une subjectivité dans la plénitude de son expression est une subjectivité générique, cosmopolitique, libérée de toute assignation identitaire (éprouvant la joie comme insertion dans le monde, amor mundi ).
17. Ainsi les deux logiques passionnelles (l’expression de la subjectivité dans le monde d’une part, l’identification des individus et des groupes les uns par rapport aux autres d’autre part), se trouvent-elles en proportion inverse : plus les conflits qui traversent la société peuvent être matérialisés, historicisés, plus la politique est susceptible de prendre le dessus (avec son éventail de solutions, de la guerre au compromis et à l’alliance) ; inversement, plus les conflits sont identitaires, imaginaires, plus ils laissent le champ libre au délire, au fanatisme, à la violence gratuite (ségrégations, génocides, exterminations, etc.).
18. Or, c’est exactement ce qui est en train d’arriver aujourd’hui, et qui risque d’arriver de plus en plus. Pourquoi ?
Dans le monde pré-moderne, les civilisations formaient autant de mondes autonomes : des « systèmes-mondes » (expression de Braudel, reprise et développée par I.Wallerstein) dotés de structures matérielles et historiques propres (systèmes de parenté, économiques, politiques, médiatiques propres). Ces systèmes-monde (« civilisations ») entretenaient entre eux peu de rapports, ou des rapports d’extériorité : ils figuraient les uns pour les autres une altérité mystérieuse, lointaine. Le barbare était celui qu’on ne comprenait pas (barbaros : celui dont le langage – et par extension la culture, les mœurs – est non-humain car incompréhensible) ; le barbare, c’était l’Autre, celui dont on attendait l’intrusion possible avec un mélange d’effroi, d’impatience et de fascination – comme dans le somptueux poème de Constantin Cavafis « En attendant les barbares »
Mais il n’y a plus aujourd’hui qu’un seul système-monde (ou, si l’on veut, une seule civilisation), qui est donc devenu un système du monde : le système-monde du capitalisme hyperindustriel, financier et spéculatif et des nouveaux médiums de communication. Ce système-monde se caractérise par une fluidification maximale des échanges entre les hommes. Le capitalisme du 21e siècle est un capitalisme « liquide » – un capitalisme qui dissout dans la logique des flux (flux financiers, flux migratoires, flux de marchandises et d’informations) toute forme « solide » de rapport social. Cette fluidification ou liquidation n’est pas une pathologie accidentelle du système : elle en est le cœur, l’essence même, comme Marx l’avait bien vu : la logique du capitalisme est de tout noyer, y compris ses propres formations, « dans l’eau glacée du calcul égoïste ». Une telle logique est non seulement destructrice de modes de vie, de traditions, de styles d’existence, mais également autodestructrice, dans la mesure où la recherche effrénée du profit, en mettant le système perpétuellement en fuite par rapport à ses formes transitoires, conduit absurdement à la chute des sources mêmes de profit.
19. Dans ce système-monde liquide, l’enjeu est de capter les flux (commerciaux, financiers, migratoires, informatiques) les plus rentables, de rejeter vers la périphérie ceux qui sont moins rentables, et plus loin encore les flux indésirables, à savoir les déchets (déchets matériels, mais aussi déchets humains, masses surnuméraires, « inutiles au monde »). La plupart des conflits contemporains, sinon tous, concernent le partage entre centre et périphérie, ou plutôt entre zones centrales, zones périphériques et zones surnuméraires ou zones poubelles. S’impose immédiatement, au niveau planétaire, l’image d’un Centre américain, avec des zones périphériques dont certaines sont émergentes (Chine, Inde, Brésil, Turquie), et d’autres déclinantes (Europe, Japon), et de larges zones surnuméraires (Somalie, Sierra Leone, Haïti, Moldavie, etc.). Mais les choses sont nettement plus embrouillées, car en fait le clivage traverse toutes les régions. Calcutta, Shanghai, Buenos Aires, Djakarta, « nœuds » d’échange performants du système-monde, appartiennent au Centre. Ces mégapoles n’ont rien à envier aux mégapoles européennes ou nord-américaines. Inversement, les banlieues de New York, de Paris ou Londres sont en position périphérique, et parfois il ne faut pas trois stations de métro pour se retrouver dans une zone surnuméraire (ghetto urbain, zone de non-droit). Le relief social du système-monde est donc à la fois très fortement clivé entre riches et pauvres, inclus et exclus, et en même temps totalement interpénétré, et évidemment interconnecté grâce à la télévision, les portables et Internet.
20. Ce système-monde qui produit « trop de civilisation, trop de commerce, trop de richesse » (Marx derechef), produit donc aussi trop de déchets, d’immondices. Le monde de la mondialisation est en passe de devenir littéralement immonde : un non-monde, ce qu’Hannah Arendt appelle worldlessness, la désolation, qui découle, non pas de l’expérience de la solitude et de l’isolement, mais d’une existence coupée de tout monde commun (citoyenneté, travail, famille, culture, loisirs), et où « seul demeure le pur effort pour se maintenir en vie »[5]. H.Arendt parlait alors des sociétés totalitaires, mais c’est elle-même en étend le concept à la société capitaliste mondialisée, dans une mise en mise en garde quasi-prophétique (1951) : « Le danger est qu’une civilisation globale, coordonnée à l’échelle universelle, se mette un jour à produire des barbares nés de son propre sein à force d’avoir imposé à des millions de gens des conditions de vie qui, en dépit des apparences, sont les conditions de vie de sauvages »[6].
21. Le barbare n’est plus l’Autre, mystérieux et lointain, qui vient d’un autre monde. Il est le proche, le familier, la Chose irreprésentable (au sens de Lacan) dont l’étrangeté n’est pas due au fait qu’il vient d’ailleurs, mais au contraire qu’il est mêlé à soi, part inextricable de soi-même empêchant néanmoins toute réappropriation, toute identification. La fixation obsessionnelle sur les identités et les cultures (la violence « ultra-subjective », comme l’appelle Balibar) est une « réponse » à l’immondialisation (la violence « ultra-objective »). Non pas que les individus se replieraient sur leur monde propre, leurs traditions, en tournant le dos à la globalisation. C’est exactement le contraire : ils n’ont plus de monde, ou craignent d’en être exclus, et ils cherchent désespérément à se couler dans les mouvements de flux du monde global. Or, quand les hommes ne connaissent plus que la désolation et l’immonde, ou éprouvent une peur panique à l’idée d’y être confrontés, il ne leur reste qu’une seule manière, totalement imaginaire et fantasmatique, de garder l’illusion de leur humanité : c’est de rejeter les autres dans l’inhumanité, de les nier dans leur humanité, et de trouver leur propre identité dans l’acte même de les discriminer et de les agresser. Les conflits ethniques des années 90 et le terrorisme des années 2000 trouvent là leur origine. On peut craindre que d’autres conflits ou violences de ce type se multiplient à l’avenir.
22. Avant tout « choc des civilisations », il faut donc voir la fracture entre centres, périphéries et surnuméraires du système-monde, qui est une fracture existentielle entre monde et non-monde, une prolifération virale du non-monde, de l’immonde. Les passions politiques contemporaines peuvent donc être interprétées comme l’expression subjective de cette immondialisation objective, avec comme conséquence la peur réciproque du Centre à l’égard de la périphérie, et de la périphérie à l’égard du Centre : peur, colère, haine des peuples subalternes envers l’Occident dominateur ; mais peur, panique des populations occidentales face à la montée en puissance des pays émergents (Chine, Inde, Turquie, etc.) et la prolifération, au cœur de leurs villes, des diasporas subalternes (avec une fixation sur l’islam).
23. Un programme politique se dessine ainsi en creux : s’attaquer avant tout à la production virulente de non-monde, de zones et de populations surnuméraires, superflues, car c’est elle qui débouche sur des conflits de type identitaire. La thèse du repli communautaire et identitaire (= les victimes de la mondialisation se replient sur les référents archaïques, créant un peu partout des ghettos culturels), n’est pas correcte. Au contraire, les identités et les cultures sont une manière de se brancher sur la mondialisation, d’affronter le devenir-immonde qui la caractérise. Ce n’est qu’à cette condition (comprendre pourquoi les fractures sociales se traduisent en luttes identitaires) que l’on pourra faire le chemin en sens inverse : réinvestir les enjeux sociaux, matériels et historiques, au détriment des questions d’identité et d’ethnicité qui surdéterminent aujourd’hui les débats publics.
24. Nous avons donc, non pas à surmonter les conflits identitaires dans une forme supérieure de consensus citoyen (sous cet angle, il faut rejeter tout uniment le « républicanisme » et le « multiculturalisme », qui partagent l’illusion que l’appartenance communautaire peut générer des passions joyeuses), mais substituer à la recherche d’un tel consensus citoyen (illusoire) le dissensus historique et politique sur le mode d’organisation même de la citoyenneté. Les véritables défis pour le « vivre-ensemble » aujourd’hui ne concernent pas le choc ou le dialogue des cultures, mais l’organisation matérielle et politique de la société. Les questions ethniques ou identitaires doivent être, non pas évacuées, mais réinvesties dans cette perspective matérielle, existentielle : luttes pour plus d’égalité concrète, réelle, dans le domaine de l’emploi, du logement, de l’enseignement, de l’urbanisme, de la santé, de la production et transmission de l’information, etc. – luttes qui ne sont donc pas seulement de type socio-économique, mais qui couvrent l’ensemble des dimensions de l’existence.
[1] Etienne Balibar, Violence et civilité. Wellek Library Lectures et autres essais de philosophie politique, Galilée, 2010.
[2] Cl.Lévi-Strauss, Anthropologie structurale deux, Plon, p.384.
[3] Etienne Balibar, Violence et civilité. Wellek Library Lectures et autres essais de philosophie politique, Galilée, 2010, p.109.
[4] Ibid., p.115.
[5] Ibid., p.226-227.
[6] Hannah Arendt, L’impérialisme (les origines du totalitarisme. 2) (1951), Seuil, 1982, p.292.